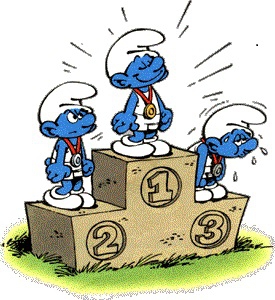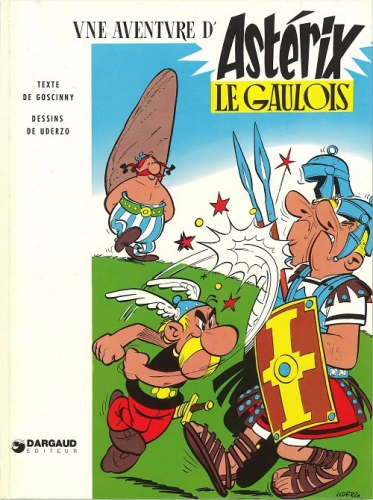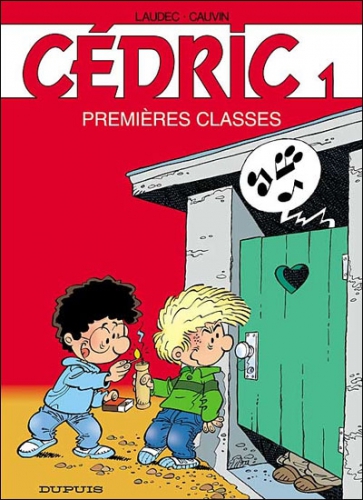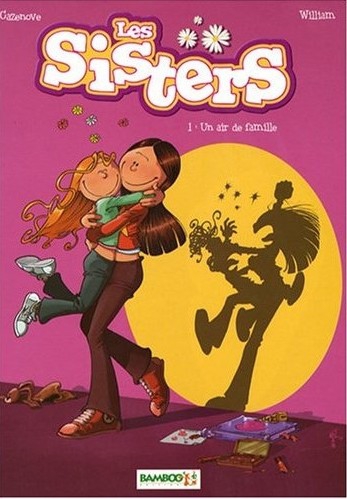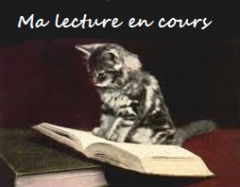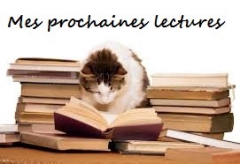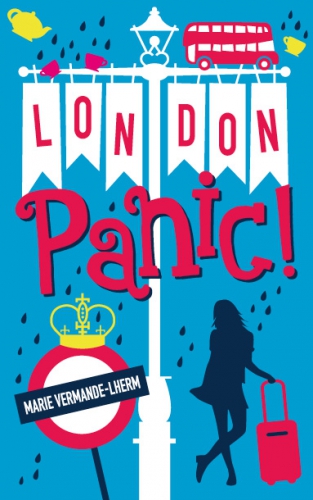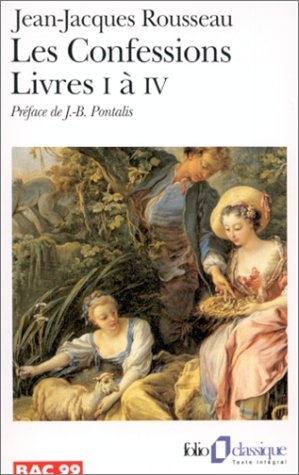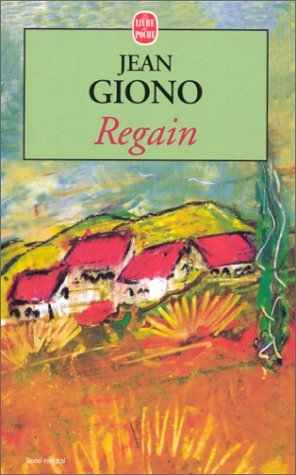Résumé : Dans l'Angleterre du début des années 1920, la jeune Margaret rêve d'être institutrice, mais elle est issue d'un milieu modeste et doit " entrer en condition ".
De fille de cuisine elle devient rapidement cuisinière, un titre envié parmi les gens de maison.
Confinée au sous-sol de l'aube à la nuit, elle n'en est pas moins au service de " ceux qu'on appelle "Eux" ", des patrons qui ne supporteraient pas de se voir remettre une lettre par un domestique autrement que sur un plateau d'argent.
Elle saura leur tenir tête et rendra souvent son tablier pour améliorer ses conditions de travail, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin, sinon le prince charmant, du moins le mari qui l'emmènera loin des cuisines des maîtres.
Auteur : Margaret Powell
Edition : Payot
Genre : Témoignage
Date de parution : 10 avril 2013
Prix moyen : 8€
Mon avis : Quand j’ai commencé ce livre, j’ai aussitôt replongé dans l’univers de Downton abbey. Peut être est-ce parce que je savais déjà qu’il avait inspiré la série, mais j’ai retrouvé les manières un peu brusque de Daisy dans la manière de s’exprimer de Margaret. Je l’imagine très bien avec un accent campagnard dans les belles maisons de Londres.
Dès le début, Margaret a dans l’idée de trouver un mari, qui ne soit pas domestique, et de quitter son emploi.
Pour une femme née avant la première guerre mondiale, elle ne mâche pas ses mots et a une manière très moderne de voir les choses et surtout les relations entre hommes et femmes.
Avant d’entrer en condition, c'est-à-dire de devenir domestique, Margaret a travaillé comme femme de ménage, puis dès qu’elle a eu l’âge, à la blanchisserie.
D’ailleurs son entrée en condition se fait un peu contre son gré : elle sait qu’elle doit travailler, elle n’est pas contre, mais la place ne lui plait guère. Mais sa mère accepte le poste en son nom. Comme le seul poste qui ne requiert pas de connaissance en couture est fille de cuisine, c’est donc par là qu’elle commencera, en espérant devenir un jour cuisinière, presque le Saint Graal chez les domestiques.
Margaret a eu la chance de travailler à une époque où le poste de fille de cuisine était facile à trouver : beaucoup de jeune fille postulaient, mais il y avait beaucoup de place à prendre. De plus, rare étaient les personnes qui conservaient ce poste longtemps. Margaret a donc pu assez facilement changer de maison, à chaque fois qu’elle ne se plaisait pas, que les patrons lui était odieux, ou qu’elle pensait avoir appris tout ce qu’elle pouvait apprendre de la cuisinière. A cette époque a succédé une période différente, mais dans laquelle il était encore facile de se placer : celle où les domestiques ont diminués, mais pas encore les employeurs. La place de fille de cuisine, puis de cuisinière, était toujours demandée, mais de moins en moins de personnes étaient disposées à l’occuper. C’est là que Margaret a vu la condition domestique s’améliorer un peu : il fallait les inciter à rester.
Plus tard, mais elle avait déjà quitté la domesticité, elle a vu, avec la seconde guerre mondiale, les revenus des employeurs diminuer et avec eux, le nombre de postes offerts. Mais elle ne se sentait plus vraiment concerné, même quand elle tirait le diable par la queue avec les faibles revenus de son mari parce qu’à l’époque une femme mariée ne travaillait pas (sauf si le mari était au chômage) parce que « ça ne se faisait pas ».
Margaret parle surtout d’elle, de comment elle perçoit ses patrons et de sa recherche d’un mari. Il est dommage qu’elle n’en dise pas un peu plus sur les autres domestiques, sur les différents postes (bien qu’elle précise que les nurses étaient à part).
Après que ses fils aient grandit, Margaret a passé des examens, jusqu’à obtenir l’équivalent du BAC en Angleterre, en 1969, à l’âge de 62 ans. Peut-être une petite revanche personnelle pour celle qui rêvait d’être institutrice.
Un extrait : Je suis allée à un bureau de placement pour les domestiques ; il y en avait à tous les coins de rue en ce temps-là. Les places de fille de cuisine aussi ça courait les rues, parce que c’était tout en bas de l’échelle des gens de maison ; et pourtant, si on voulait devenir cuisinière et qu’on n’avait pas de quoi se payer des cours, le seul moyen d’apprendre le métier c’était de commencer comme fille de cuisine.
On m’a proposé plusieurs places, et finalement j’en ai choisi une dans Adelaide Crescent, à Hove, parce que ça ne faisait pas trop loin de chez nous. C’est là qu’habitaient le révérend Clydesdale et sa femme. Ma mère est venue avec moi pour l’entretien d’embauche.
Dans Adelaide Crescent les maisons étaient immenses. Pour aller du sous-sol au grenier il y avait bien cent trente marches, et les sous-sols étaient sombres comme des cachots. La partie qui donnait sur la rue, là où il y avait des barreaux aux fenêtres, c’était la salle des domestiques. Quand on était assis dans cette pièce, tout ce qu’on voyait c’étaient les jambes des passants, et quand on était de l’autre côté, c’est-à-dire dans la cuisine, on ne voyait rien du tout à cause d’un jardin d’hiver en saillie juste au-dessus. Il y avait une minuscule fenêtre en haut du mur, mais pour voir dehors on devait grimper sur une échelle. Il fallait laisser la lumière allumée toute la journée.
Adelaide Crescent, c’est une des plus belles rues de Hove. Les maisons étaient de style Regency, et même maintenant qu’elles ont été transformées en appartements, comme les façades ont été conservées ça ressemble beaucoup à ce que c’était, avec les jardins au milieu. Naturellement, autrefois il n’y avait que les résidents qui avaient la clé et qui pouvaient profiter des jardins – mais bien sûr ça ne s’appliquait pas aux domestiques, ça je vous le certifie !
Ma mère et moi, quand on est arrivées pour l’entretien on s’est présentées à la porte principale de la maison. Pendant tout le temps où j’ai travaillé chez les Clydesdale, c’est bien la seule fois où je suis passée par la grande porte. On nous a fait entrer dans un vestibule qui m’a paru le comble du luxe. Il y avait un beau tapis par terre et un escalier très large entièrement recouvert de moquette – rien à voir avec le petit bout de lino qu’on avait posé chez nous au milieu des marches ! Dans le vestibule il y avait aussi une table en acajou, un portemanteau en acajou, et des miroirs immenses avec des cadres dorés. Pour moi ça respirait tellement la richesse que je me suis dit que les Clydesdale étaient sûrement millionnaires. Je n’avais jamais rien vu de pareil.
C’est un majordome qui nous avait ouvert, et ma mère avait dit que j’étais Margaret Langley et que je venais pour la place de fille de cuisine. Ce majordome, c’était un vrai nabot ; moi qui croyais que les majordomes étaient toujours grands et imposants ! Dans le vestibule on a vu un monsieur assez âgé et la dame qui allait nous recevoir pour l’entretien, et on nous a fait entrer dans une pièce qui était visiblement la salle de jeux des enfants.
C’est ma mère qui a parlé tout le temps, parce que moi j’étais abasourdie : dans cette pièce-là on aurait pu mettre sans problème les trois où je vivais avec ma famille, alors que c’était juste une salle de jeux. Et puis j’étais paralysée par la timidité. Ce que je pouvais être mal à l’aise en ce temps-là, c’était horrible ! Il faut dire que la dame, Mrs Clydesdale, m’examinait de la tête aux pieds comme si on était au marché aux esclaves. Elle avait l’air de soupeser mes capacités.
Ma mère lui a dit que j’avais déjà fait des ménages. Elle n’a pas parlé de la blanchisserie, parce que d’après elle ce n’était pas une référence. Les gens croyaient que les blanchisseries étaient des « antres du vice », comme on disait, parce que les filles qui y travaillaient étaient malpolies.
Mrs Clydesdale a décidé que comme j’étais robuste et en bonne santé je ferais l’affaire. Je serais payée vingt-quatre livres par an et je toucherais mon salaire tous les mois. J’aurais un après-midi plus une soirée de congé par semaine, de quatre heures à dix heures, et un dimanche sur deux aux mêmes heures ; je ne devais jamais rentrer après dix heures, sous aucun prétexte. Il faudrait que j’aie trois robes en tissu imprimé bleu ou vert ; quatre tabliers blancs à bavette et quatre bonnets ; des bas et des chaussures noires à lanière. Je devais toujours dire « Monsieur » et « Madame » à Mr et Mrs Clydesdale quand ils m’adressaient la parole, montrer beaucoup de respect aux domestiques de haut rang et faire tout ce que la cuisinière me dirait.
À chaque fois ma mère a répondu « Oui, Madame » ou « Non, Madame ». Elle a promis de ma part que je ferais tout ça. Moi, plus ça allait plus j’étais démoralisée, et à la fin j’avais l’impression d’être prisonnière.
En sortant je l’ai dit à maman, mais comme elle avait décidé que la place me convenait la question était réglée.