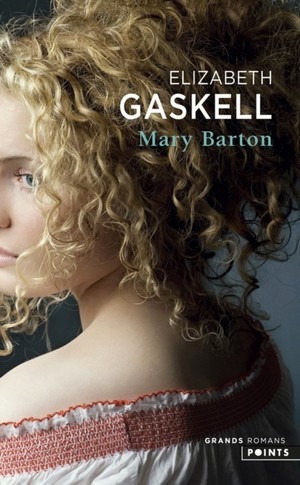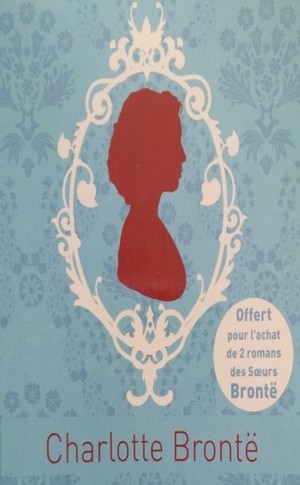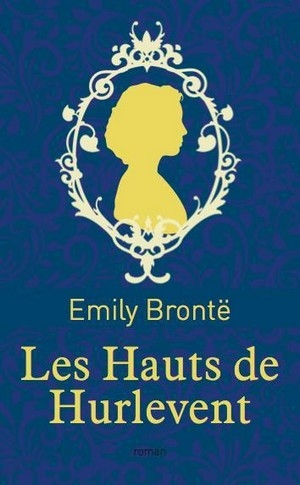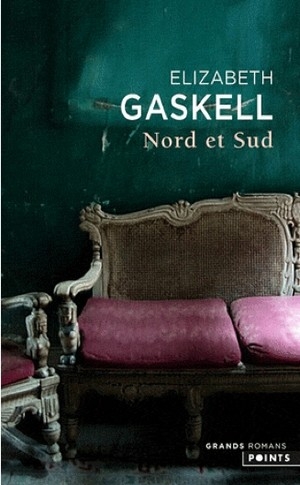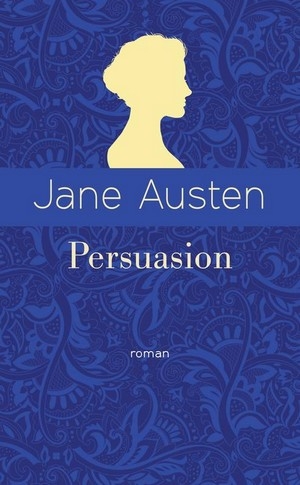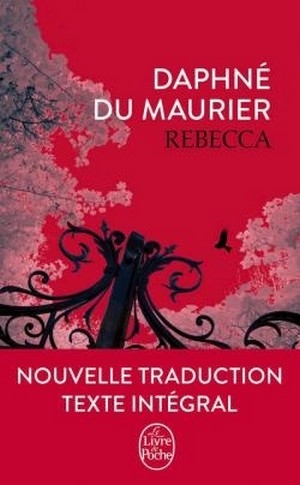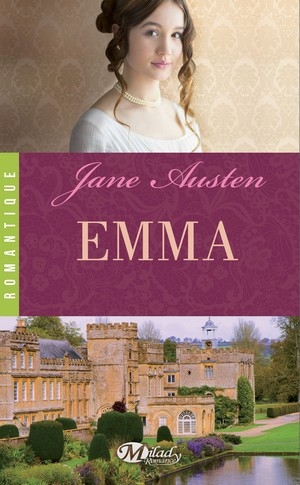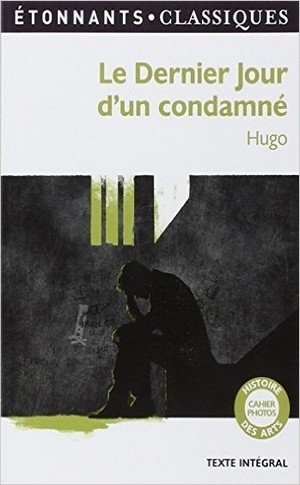Lecture terminée le : 04 juillet 2019
Résumé : Elles sont trois, ces dames de la famille Kimoto, avec leurs amours, leurs passions, leurs drames qui racontent le destin de la femme japonaise de la fin du XIXe siècle à aujourd'hui.
Auteur : Sawako Ariyoshi
Edition : Folio
Genre : Classique
Date de parution : 2018 dans cette édition. Première édition 1959 ; première édition française 1983
Prix moyen : 7€
Mon avis : La mère, la fille, la petite-fille : de la fin du XIXème siècle à la fin des années 50, ce sont ces trois générations de femmes que l’on va suivre.
On reste néanmoins du côté du point de vue de Hana que l’on suit de son mariage, à l’âge de 22 ans, à sa mort.
Hana, élevée par sa grand-mère, construit sa vie selon la plus pure des traditions concernant le rôle et la place de la femme dans la société japonaise.
Elle refuse catégoriquement l’évolution de la société. Son attitude montre bien que les traditions archaïques qui relèguent les femmes au rôle de quasi-esclave sont pérennisées non pas par les hommes, mais bien par les femmes.
Quand sa fille, Fumio, cherche à s’émanciper du carcan de la tradition, elle provoque le désespoir de sa mère et même parfois des réactions violentes. Hana va faire pression sur son époux, qui serait plutôt partisan de laisser sa fille agir à sa guise, pour qu’il remette la demoiselle dans le rang, mais en vain.
Fumio n’est guère délicate, mais il est fort à parier que la douceur ne lui aurait pas permis de s’extirper du destin qui aurait dû être le sien.
La fille de Fumio, elle, dont la jeunesse va être bouleversée par la seconde guerre mondiale et la transformation politique du pays, va faire le lien entre modernité et tradition par la nostalgie qu’elle ressent pour cette dernière qu’elle n’a pas vraiment vécu.
L’histoire est belle, bien écrite et prenante.
Toutefois, j’ai un reproche à lui faire : A chaque fois que Fumio essuie un revers de fortune, c’est lié à son refus de suivre une tradition, comme si le sort la punissait de refuser de se plier aux croyances de sa mère. Je trouve dommage qu’un auteur qu’on a comparé à Simone de Beauvoir entérine l’asservissement de la femme en laissant entendre que tout se serait bien passé pour Fumio si elle était restée à sa place et s’était soumise aux désirs de sa mère.
Certaines de ces traditions sont incompréhensibles pour un occidental moderne, comme l’obligation pour une jeune fille qui se marie de rompre les liens avec sa famille puisqu’elle « appartient » dorénavant à celle de son mari, ou encore l’obligation pour les fils cadet de partir fonder une nouvelle branche, sans héritage et sans le droit de conserver le nom de famille.
D’autres semblent ridicules comme devoir nettoyer les toilettes quand on est enceinte pour assurer un accouchement facile (mais au moins, les toilettes seront propres, c’est déjà ça !).
J’ai quand même eu l’impression constante que l’auteur voyait d’un mauvais œil l’abandon des traditions car elle ne cesse de montrer des conséquences désastreuses à leur non-respect.
Cette lecture était agréable même si j’ai regretté que le livre prenne le parti des traditions archaïques plutôt que de montrer les côtés positifs de l’évolution.
Un extrait : Tenant sa petite-fille Hana par la main, Toyono gravissait l’escalier de pierre d’une démarche décidée qui surprenait chez une femme de cet âge. Elle allait avoir soixante-seize ans et, renouant avec une habitude abandonnée depuis longtemps, elle avait fait venir, trois jours auparavant, une coiffeuse de Wakayama : ses cheveux blancs gonflés sur les côtés et relevés en arrière en un volumineux chignon – arrangement un peu trop jeune pour elle soulignaient ce que la journée avait d’exceptionnel. Sa chevelure épaisse et luisante gardait la trace de la beauté qu’elle avait eue autrefois, avant de perdre sa couleur de jais. Toyono, vêtue pour cette visite solennelle de deux kimonos superposés à petits motifs réguliers, semblait aider la jeune fille à monter les marches plutôt que s’appuyer sur elle. L’allure imposante de la Dame de Kimoto s’expliquait parce qu’en ce jour sa petite-fille quittait définitivement la demeure familiale pour se marier.
Le mont Kudo était encore voilé par les brumes matinales de ce début de printemps. La main serrée dans celle de sa grand-mère, Hana franchissait les dernières marches de pierre. Elle aussi était coiffée avec recherche – une coiffure de mariée aux coques luisantes – et l’éclat rosé de son teint de jeune fille transparaissait sous l’austère maquillage blanc. Elle portait un kimono de cérémonie de crêpe de soie violet à très longues manches, et le gland de métal accroché à la pochette glissée entre les pans croisés du kimono tintait légèrement à chaque pas. Hana était si tendue qu’elle vibrait au bruit. L’étreinte de la main autour de la sienne lui rappelait que, maintenant qu’elle allait être admise comme bru dans une nouvelle famille, elle cesserait d’appartenir à celle où elle avait vécu les vingt années de son existence. Elle lui disait aussi la tristesse et le regret de sa grand-mère qui devait se résoudre à la laisser partir.
Le prieur du temple Jison, averti la veille de leur visite, les attendait devant le pavillon consacré à Miroku. Il n’avait pas revêtu sa robe sacerdotale car Toyono avait précisé qu’elles ne venaient pas assister à son office. Il s’inclina avec déférence devant l’aïeule d’une famille qui, depuis des générations, manifestait un intérêt bienveillant à la trésorerie de son temple.