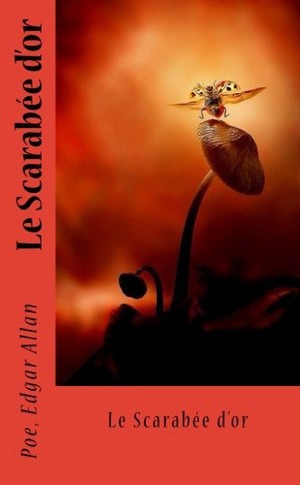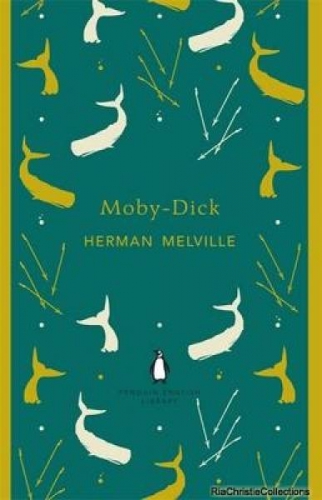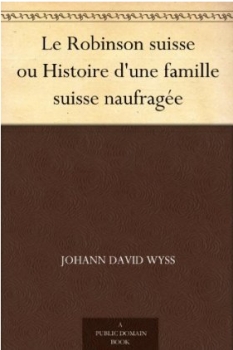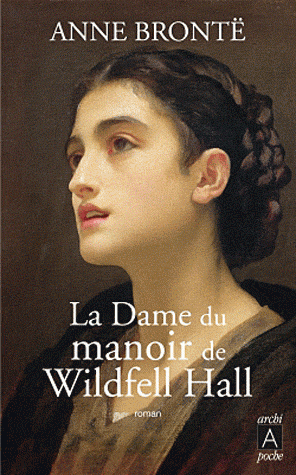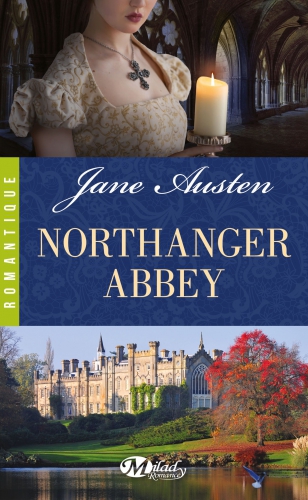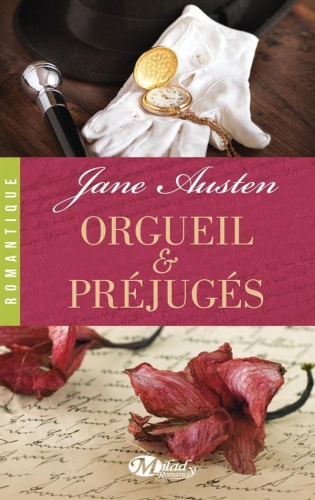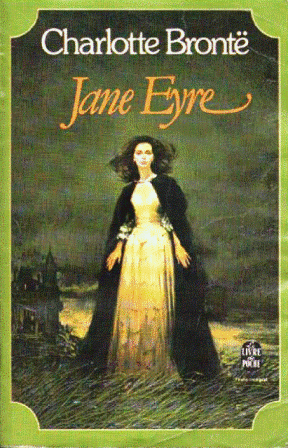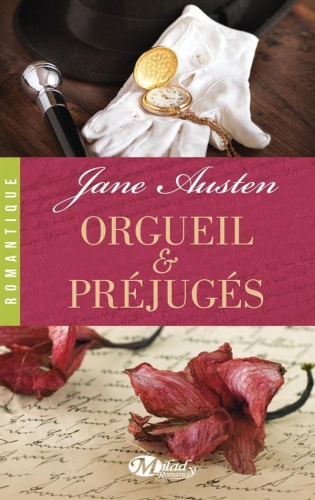
Résumé : Élisabeth Bennet a quatre sœurs et une mère qui ne songe qu'à les marier. Quand parvient la nouvelle de l'installation à Netherfield, le domaine voisin, de Mr Bingley, célibataire et beau parti, toutes les dames des alentours sont en émoi, d'autant plus qu'il est accompagné de son ami Mr Darcy, un jeune et riche aristocrate. Les préparatifs du prochain bal occupent tous les esprits...
Jane Austen peint avec ce qu'il faut d'ironie les turbulences du cœur des jeunes filles et, aujourd'hui comme hier, on s'indigne avec l'orgueilleuse Élisabeth, puis on ouvre les yeux sur les voies détournées qu'emprunte l'amour...
Auteur : Jane Austen
Edition : Milady
Genre : Classique étranger
Date de parution :
Prix moyen : 5€
Mon avis : Enfin, après avoir lu et adoré Raison et sentiments, vu orgueil et préjugés en mini-série de 6 épisodes avec les excellents Colin Firth et Jennifer Ehle, lu de multiples réécriture de ses œuvres, j’ai enfin trouvé le temps de m’attaquer à Orgueil et préjugés !
Rien à dire sur l’écriture, je retrouve tout ce que j’avais aimé dans Raison et Sentiments : une héroïne sympathique et raisonnable, une famille qui l’est moins, un style addictif…
Elisabeth et Jane sont vraiment les deux seules Bennet qu’on puisse sauver dans cette famille de fou, quoique Elisabeth ait tendance à porter des jugements à l’emporte-pièce et Jane, au contraire, à se montrer trop bienveillante : leurs deux plus jeunes sœurs sont à l’image de leur mère : stupide, égoïste et mal élevée, avec un sens des convenances frisant le zéro absolu. Leur père, quoique plus intelligent, semble avoir pour habitude de dire ce qu’il pense sans se soucier de qui peut l’entendre et de ce que cela peut avoir comme effet négatif sur sa propre réputation et celle de ses filles, et surtout de ses filles aînées. Quant à l’enfant du milieu : Mary, elle se sert de la culture comme un moyen d’être au centre de l’attention sans aucune capacité de parler à bon escient ou de savoir s’arrêter, surtout quand elle joue de la musique.
On passera sur le cousin éloigné, Mr Collins, qui est ridicule avec ses manières et ses certitudes qui cachent une âme de cloporte.
Devant le portrait de cette famille, peut-on vraiment blâmer Mr Darcy d’avoir eu des réserves et même de sacrés inquiétudes à l’idée de voir son ami se lier de manière définitive avec eux ?
S’il a un tort (et il en a) c’est de ne pas être assez franc avec son ami, de le manipuler, et de trop l’être avec Elisabeth, l’humiliant volontairement au nom de la franchise.
Je reproche également à Mr Bingley de ne pas être capable de prendre la moindre décision sans l’approbation de Darcy et les applaudissements de ses sœurs, lesquelles sont hautaines et prétentieuses.
Même si on peut facilement deviner comment les choses vont se terminer, le plus intéressant est de voir le cheminement jusqu’à cette fin.
Il est difficile de ne pas raconter tout le roman tant on a l’impression que tout le monde le connaît. Avant même de le lire, de lire une de ses réécriture ou de voir la série, je savais déjà ce qui se passait et comment ça se terminait (un peu comme autant en emporte le vent).
Du coup, je vais arrêter là en disant que c’est un super roman et que, même si vous croyez le connaître, si vous ne l’avez jamais lu, foncez !
Un extrait : C’est une vérité universellement reconnue qu’un célibataire pourvu d’une belle fortune doit avoir envie de se marier, et, si peu que l’on sache de son sentiment à cet égard, lorsqu’il arrive dans une nouvelle résidence, cette idée est si bien fixée dans l’esprit de ses voisins qu’ils le considèrent sur-le-champ comme la propriété légitime de l’une ou l’autre de leurs filles.
– Savez-vous, mon cher ami, dit un jour Mrs. Bennet à son mari, que Netherfield Park est enfin loué ?
Mr. Bennet répondit qu’il l’ignorait.
– Eh bien, c’est chose faite. Je le tiens de Mrs. Long qui sort d’ici.
Mr. Bennet garda le silence.
– Vous n’avez donc pas envie de savoir qui s’y installe ! s’écria sa femme impatientée.
– Vous brûlez de me le dire et je ne vois aucun inconvénient à l’apprendre.
Mrs. Bennet n’en demandait pas davantage.
– Eh bien, mon ami, à ce que dit Mrs. Long, le nouveau locataire de Netherfield serait un jeune homme très riche du nord de l’Angleterre. Il est venu lundi dernier en chaise de poste pour visiter la propriété et l’a trouvée tellement à son goût qu’il s’est immédiatement entendu avec Mr. Morris. Il doit s’y installer avant la Saint-Michel et plusieurs domestiques arrivent dès la fin de la semaine prochaine afin de mettre la maison en état.
– Comment s’appelle-t-il ?
– Bingley.
– Marié ou célibataire ?
– Oh ! mon ami, célibataire ! célibataire et très riche ! Quatre ou cinq mille livres de rente ! Quelle chance pour nos filles !
– Nos filles ? En quoi cela les touche-t-il ?
– Que vous êtes donc agaçant, mon ami ! Je pense, vous le devinez bien, qu’il pourrait être un parti pour l’une d’elles.
– Est-ce dans cette intention qu’il vient s’installer ici ?
– Dans cette intention ! Quelle plaisanterie ! Comment pouvez-vous parler ainsi ?… Tout de même, il n’y aurait rien d’invraisemblable à ce qu’il s’éprenne de l’une d’elles. C’est pourquoi vous ferez bien d’aller lui rendre visite dès son arrivée.
– Je n’en vois pas l’utilité. Vous pouvez y aller vous-même avec vos filles, ou vous pouvez les envoyer seules, ce qui serait peut-être encore préférable, car vous êtes si bien conservée que Mr. Bingley pourrait se tromper et égarer sur vous sa préférence.
– Vous me flattez, mon cher. J’ai certainement eu ma part de beauté jadis, mais aujourd’hui j’ai abdiqué toute prétention. Lorsqu’une femme a cinq filles en âge de se marier elle doit cesser de songer à ses propres charmes.
– D’autant que, dans ce cas, il est rare qu’il lui en reste beaucoup.
– Enfin, mon ami, il faut absolument que vous alliez voir Mr. Bingley dès qu’il sera notre voisin.
– Je ne m’y engage nullement.
– Mais pensez un peu à vos enfants, à ce que serait pour l’une d’elles un tel établissement ! Sir William et lady Lucas ont résolu d’y aller uniquement pour cette raison, car vous savez que, d’ordinaire, ils ne font jamais visite aux nouveaux venus. Je vous le répète. Il est indispensable que vous alliez à Netherfield, sans quoi nous ne pourrions y aller nous-mêmes.
– Vous avez vraiment trop de scrupules, ma chère. Je suis persuadé que Mr. Bingley serait enchanté de vous voir, et je pourrais vous confier quelques lignes pour l’assurer de mon chaleureux consentement à son mariage avec celle de mes filles qu’il voudra bien choisir. Je crois, toutefois, que je mettrai un mot en faveur de ma petite Lizzy.
– Quelle idée ! Lizzy n’a rien de plus que les autres ; elle est beaucoup moins jolie que Jane et n’a pas la vivacité de Lydia.
– Certes, elles n’ont pas grand’chose pour les recommander les unes ni les autres, elles sont sottes et ignorantes comme toutes les jeunes filles. Lizzy, pourtant, a un peu plus d’esprit que ses sœurs.