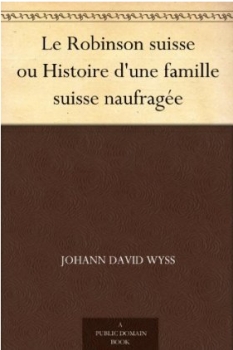
Résumé : Quel heureux homme que ce Robinson suisse ! Il a en effet sauvé du naufrage sa famille au complet. Les débris du vaisseau vont être pour lui l'occasion de prouver de quoi il est capable. Au milieu d'une nature tour à tour généreuse et hostile, périlleuse et insolite, il va reconstruire sa vie quotidienne à force d'ingéniosité et de courage.
Auteur : Johann David Wyss
Edition : CreateSpace Independent Publishing Platform
Genre : Classique étranger
Date de parution : 2012 (pour cette édition)
Prix moyen : 14€
Mon avis : Ce livre ne fait pas l’unanimité comme j’ai pu le voir en lisant les avis sur internet. Toutefois, la plupart du temps, à la lecture des critiques, j’ai eu l’impression que le livre n’avait pas été compris.
Souvent, les gens se plaignent de la trop grande facilité que ces Robinson suisses ont à trouver tout le nécessaire à leur survie et à leur confort, ainsi que du coté moralisateur et monsieur je-sais-tout du père. Ils analysent le livre comme ils le feraient de tout roman d’aventure.
Or, un livre écrit par un pasteur à la fin du XVIIIème siècle (bien que publié en 1812, il a été écrit en 1794) n’a pas vocation à être un divertissement. Le titre d’origine était « La Famille suisse Robinson ou Le Prédicateur suisse naufragé et sa famille. Un livre didactique pour les enfants et les enfants des amis à la ville et la campagne ».
Son but était donc de faire passer un message.
Ici, ce message s’oriente autour de la religion (vous me direz, normal pour un pasteur).
D’abord, l’auteur s’attache à rappeler la toute puissance paternelle, garante de la moralité et de la sauvegarde de la famille. L’obéissance filiale aveugle étant, à l’époque, au sommet de la religion, juste avant celle dû à Dieu, il n’est guère étonnant d’avoir ici un père quasiment infaillible dont les quelques rares lacunes n’ont d’autre but que de le laisser soumis à la bienveillance de Dieu et de permettre à ses fils de se former au métier d’adulte sans pour autant les délivrer du joug paternel.
Ensuite, l’auteur met en avant l’action divine.
Dieu étant supposé récompenser ses fidèles les plus dévoués, il n’est guère étonnant de voir la facilité avec laquelle les Robinsons pourvoient à leurs besoins.
Le message dispensé est donc de garder foi en Dieu dans les épreuves (naufrage puis exil), de le remercier sans cesse de ses bontés (les nombreuses prières, et qu’on attirera ainsi la bienveillance de Dieu.
J’ai vu aussi beaucoup de critiques sur les massacres d’animaux perpétrés par la famille.
Il faut se remettre dans le contexte. En 1794, l’esclavage existait toujours, les femmes pouvaient compter leurs droits sur les doigts d’une main, les enfants appartenaient à leur père comme de simples meubles, les domestiques étaient soumis à leurs employeurs… Alors franchement les animaux… (Il a quand même fallut attendre le XXIème siècle pour qu’ils perdent le statut de meubles et gagnent celui d’êtres dotés de sensibilité)… Si ce genre de massacre me choque dans l’absolu, en revanche, je ne suis pas choquée d’en trouver dans un livre écrit à cette époque.
Si j’ai une critique à faire, c’est que le père est constamment dans le reproche, et surtout, qu’il se montre parfois assez hypocrite.
Par exemple, il réprimande son fils pour mensonge alors que ce dernier, en prétendant n’avoir rien chassé, ne voulait que faire une surprise à ses frères, puis, il demande à ses fils de mentir à leur mère pour exactement les mêmes raisons.
J’ai aussi trouvé qu’il ne montrait pas le bon exemple en ne s’excusant jamais, notamment quand il se rendait compte que ses reproches ne sont pas fondés.
L’ellipse de 8 ans, à la fin, est compréhensible et le narrateur lui-même explique, que, passée les deux premières années, l’existence des naufragés devient trop répétitive pour être racontée sans ennuyer.
Même si ce livre est plus un livre de morale qu’autre chose, je l’ai beaucoup aimé.
Cela dit, je le déconseille à la fois à ceux qui n’aiment pas les classiques et à ceux qui aspirent à trouver des notions modernes dans leurs lectures.
Un extrait : La tempête durait depuis six mortels jours, et, le septième, sa violence, au lieu de diminuer, semblait augmenter encore. Elle nous avait jetés vers le S.-O., si loin de notre route, que personne ne savait où nous nous trouvions. Les passagers, les matelots, les officiers étaient sans courage et sans force ; les mâts, brisés, étaient tombés par-dessus le bord ; le vaisseau, désemparé, ne manœuvrait plus, et les vagues irritées le poussaient ça et là. Les matelots se répandaient en longues prières et offraient au Ciel des vœux ardents ; tout le monde était du reste dans la consternation, et ne s’occupait que des moyens de sauver ses jours.
« Enfants, dis-je à mes quatre fils effrayés et en pleurs, Dieu peut nous empêcher de périr s’il le veut ; autrement soumettons-nous à sa volonté ; car nous nous reverrons dans le ciel, où nous ne serons plus jamais séparés. »
Cependant ma courageuse femme essuyait une larme, et, plus tranquille que les enfants, qui se pressaient autour d’elle, elle s’efforçait de les rassurer, tandis que mon cœur, à moi, se brisait à l’idée du danger qui menaçait ces êtres bien-aimés. Nous tombâmes enfin tous à genoux, et les paroles échappées à mes enfants me prouvèrent qu’ils savaient aussi prier, et puiser le courage dans leurs prières. Je remarquai que Fritz demandait au Seigneur de sauver les jours de ses chers parents et de ses frères, sans parler de lui-même.
Cette occupation nous fit oublier pendant quelque temps le danger qui nous menaçait, et je sentis mon cœur se rassurer un peu à la vue de toutes ces petites têtes religieusement inclinées. Soudain nous entendîmes, au milieu du bruit des vagues, une voix crier : « Terre ! terre ! » et au même instant nous éprouvâmes un choc si violent, que nous en fûmes tous renversés, et que nous crûmes le navire en pièces ; un craquement se fit entendre ; nous avions touché. Aussitôt une voix que je reconnus pour celle du capitaine cria : « Nous sommes perdus ! Mettez les chaloupes en mer ! » Mon cœur frémit à ces funestes mots : Nous sommes perdus ! Je résolus cependant de monter sur le pont, pour voir si nous n’avions plus rien à espérer. À peine y mettais-je le pied qu’une énorme vague le balaya et me renversa sans connaissance contre le mât. Lorsque je revins à moi, je vis le dernier de nos matelots sauter dans la chaloupe, et les embarcations les plus légères, pleines de monde, s’éloigner du navire. Je criai, je les suppliai de me recevoir, moi et les miens… Le mugissement de la tempête les empêcha d’entendre ma voix, ou la fureur des vagues de venir nous chercher. Au milieu de mon désespoir, je remarquai cependant avec un sentiment de bonheur que l’eau ne pouvait atteindre jusqu’à la cabine que mes bien-aimés occupaient au-dessous de la chambre du capitaine ; et, en regardant bien attentivement vers le S., je crus apercevoir par intervalles une terre qui, malgré son aspect sauvage, devint l’objet de tous mes vœux.