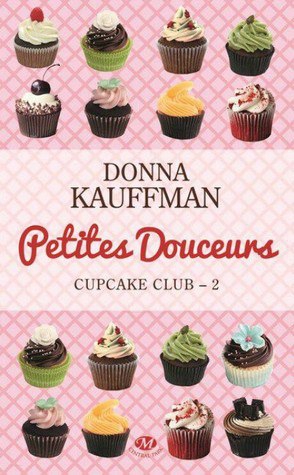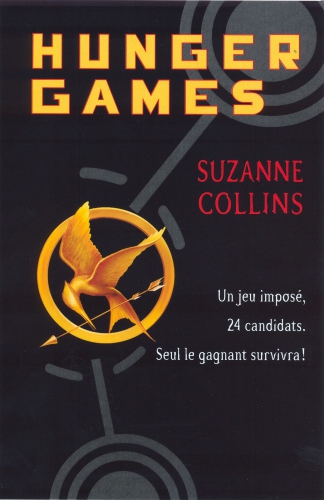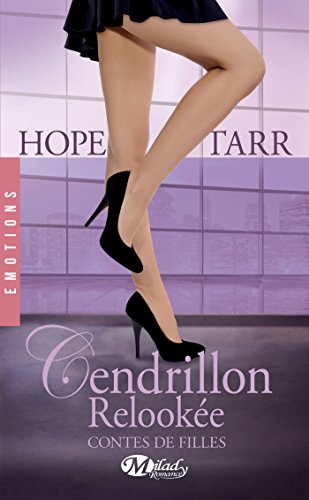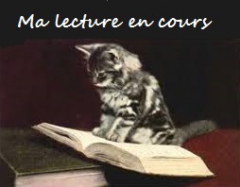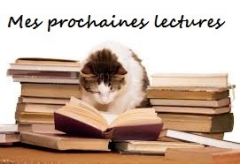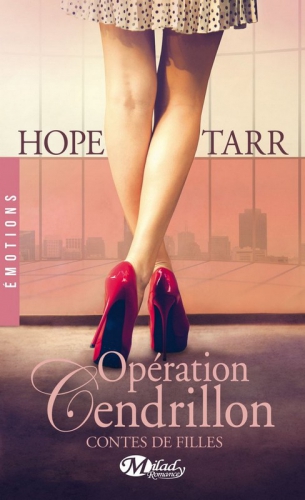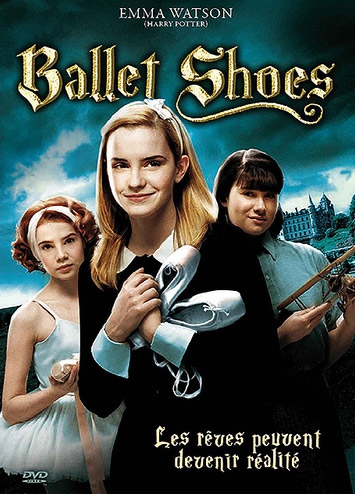Résumé : 23 décembre 1980. Un crash d'avion dans le Jura. Une petite libellule de 3 mois tombe du ciel, orpheline. Deux familles que tout oppose se la disputent. La justice tranche : elle sera Émilie Vitral. Aujourd'hui, elle a 18 ans, la vie devant elle mais des questions plein la tête. Qui est-elle vraiment ?
Dix-huit ans que Crédule Grand-Duc, détective privé, se pose la même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant ses yeux, qu'il referme aussitôt, assassiné.
Il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc, son frère, pour découvrir la vérité...
Auteur : Michel Bussi
Edition : Pockett
Genre : Thriller
Date de parution : 12 janvier 2012
Prix moyen : 8€
Mon avis : Ce livre est à déconseiller aux inconditionnels de Columbo. En effet, pas question ici de connaître la solution avant les dernières pages. Difficile aussi de la deviner, puisque l’indice principal, primordial, connu de certains protagonistes, ne nous est dévoilé qu’à la presque toute fin. Un peu plus Poirot que Columbo donc.
J’avoue que c’est parfois un peu agaçant de n’avoir pas les indices nécessaires pour essayer de comprendre, comme si l’auteur ne se pensait pas capable de distiller des indices susceptibles de résoudre l’intrigue mais sans trop de facilité non plus. Alors il préfère attendre les dernières pages pour sortir l’As de sa poche, l’indice, qui est tellement éclairant qu’on ne peut même plus, en fait, l’appeler un indice.
Pour ceux qui aiment résoudre les énigmes en lisant, c’est frustrant.
Cependant, l’écriture de Michel Bussi fait que, malgré cela, le roman devient très vite addictif.
Au fil de la lecture, on passe de certitudes en incertitudes. La justice s’est trompée, le bébé est Lyse-Rose ; Ah oui mais non, finalement c’est bien Emilie… Quoi que…
Et ainsi de suite…
On suit l’enquête de Marc avec impatience, on n’arrive pas à tourner les pages assez vite pour assouvir notre soif de vérité, de réponses.
Nos sentiments pour les personnages balancent entre compassion, indignation, espoir…
Je suis incapable de parler vraiment du style d’écriture ce qui veut dire qu’il est bon : Je n’aurais pas pu me plonger aussi profondément dans un roman s’il avait été truffé de fautes de syntaxe, si les dialogues n’avaient pas été crédibles, si le style avait été lourd… C’est comme ça, je ne remarque vraiment le style que s’il ne me plait pas.
Bussi a décidé de faire dans la caricature : les riches sont odieux, les pauvres sont humbles, vaillants et gentils, le détective est limite obsessionnel, et Lylie « la libellule » est limite parfaite… Avec un auteur moins doué, cet étalage de stéréotypes aurait été rédhibitoire… Mais ici, ça passe comme une lettre à la poste.
Lylie, même si elle est au centre de l’intrigue est quasi absente du livre : d’elle, on n’a que quelques messages, de très brefs passages, des souvenirs… Elle est quasi absente mais omniprésente.
Au final c’est un roman dont le point fort est le style prenant mais j’ai regretté de ne pas avoir les indices nécessaires pour résoudre l’enquête et le coté caricatural des personnages.
Un extrait : 23 décembre 1980, 00 h 33
L’Airbus 5403 Istanbul-Paris décrocha. Un plongeon de près de mille mètres en moins de dix secondes, presque à la verticale, avant de se stabiliser à nouveau. La plupart des passagers dormaient. Ils se réveillèrent brusquement, avec la sensation terrifiante de s’être assoupis sur le fauteuil d’un manège de foire.
Ce furent les hurlements qui brisèrent net le fragile sommeil d’Izel, pas les soubresauts de l’avion. Les bourrasques, les trous d’air, elle en avait l’habitude, depuis presque trois ans qu’elle enchaînait les tours du monde pour Turkish Airlines. C’était son heure de pause. Elle dormait depuis moins de vingt minutes. Elle avait à peine ouvert les yeux que sa collègue de garde, Meliha, une vieille, penchait déjà vers elle son décolleté boudiné.
— Izel ? Izel ? Fonce ! C’est chaud. C’est la tempête, dehors, il paraît. Zéro visibilité, d’après le commandant. Tu prends ton allée ?
Izel afficha l’air lassé de l’hôtesse expérimentée qui ne panique pas pour si peu. Elle se leva de son siège, réajusta son tailleur, tira un peu sur sa jupe, admira un instant le reflet de son joli corps de poupée turque dans l’écran éteint devant elle et avança vers l’allée de droite.
Les passagers réveillés ne hurlaient plus, mais ouvraient des yeux plus étonnés qu’inquiets. L’avion continuait de tanguer. Izel entreprit de se pencher avec calme sur chacun d’entre eux.
— Tout va bien. Aucun souci. On traverse simplement une tempête de neige au-dessus du Jura. On sera à Paris dans moins d’une heure.
Le sourire d’Izel n’était pas forcé. Son esprit vagabondait déjà vers Paris. Elle devait y rester trois jours, jusqu’à Noël. Elle était excitée comme une gamine à l’idée de jouer les Stambouliotes libérées dans la capitale française.
Ses attentions rassurantes se posèrent successivement sur un garçon de dix ans qui s’accrochait à la main de sa grand-mère, sur un jeune cadre à la chemise froissée qu’elle aurait volontiers recroisé le lendemain sur les Champs-Elysées, sur une femme turque dont le voile, sans doute mal ajusté à cause du réveil brutal, lui barrait la moitié des yeux, sur un vieil homme recroquevillé sur lui-même, les mains coincées entre ses genoux, qui lui jetait un regard implorant…
— Tout va bien. Je vous assure.
Izel progressait calmement dans l’allée quand l’Airbus pencha à nouveau sur le côté. Quelques cris fusèrent. Un jeune type assis sur la droite d’Izel, qui tenait à deux mains un baladeur-cassette, cria d’un air faussement enjoué :
— C’est pour quand, le looping ?
Quelques rires timides lui répondirent, immédiatement couverts par les cris d’un nourrisson. L’enfant était allongé dans un cosy juste devant Izel. A quelques mètres. Le regard de l’hôtesse de l’air se posa sur la petite fille âgée à peine de quelques mois, elle portait une robe blanche à fleurs orange qui dépassait d’un pull de laine écru en jacquard.
— Non, madame, intervint Izel. Non !
La mère, assise juste à côté, détachait sa ceinture pour se pencher vers sa fille.
— Non, madame, insista Izel. Vous devez rester attachée. C’est impératif. C’est…
La mère ne se donna même pas la peine de se retourner, encore moins de répondre à l’hôtesse. Ses longs cheveux dénoués tombaient dans le cosy. Le bébé hurla, plus fort encore.
Izel hésita sur la conduite à tenir, se rapprocha.
L’avion décrocha encore. Trois secondes, mille nouveaux mètres, peut-être.
De brefs cris explosèrent, mais la plupart des passagers gardèrent le silence. Muets. Conscients que le mouvement de l’avion n’était plus simplement provoqué par de simples rafales hivernales. Sous l’effet de la secousse, Izel tomba sur le côté. Son coude enfonça le baladeur-cassette dans la poitrine de son propriétaire, sur sa droite, lui coupant le souffle. Elle ne prit même pas le temps de s’excuser, se redressa. Juste devant elle, la fillette de trois mois pleurait toujours. Sa mère se penchait à nouveau vers elle, commençait à détacher la ceinture de sécurité de l’enfant…
— Non, madame ! Non…
Izel pesta. Elle tira machinalement sa jupe relevée sur son bas filé. Quelle galère ! Elle les aurait bien mérités, ses trois jours et deux nuits de plaisirs à Paris !
Tout alla alors très vite.
Un bref instant, Izel crut entendre, en écho, un autre cri de nourrisson, quelque part dans l’avion, un peu plus loin sur sa gauche. La main troublée du type au baladeur frôla le nylon gris de ses cuisses. Le vieil homme turc avait passé une main autour de l’épaule de la femme voilée et levait l’autre vers Izel, suppliante. La mère, juste devant elle, debout, tendait les bras pour serrer sa fille libérée des sangles de son cosy.
Ce furent les dernières images avant la collision, avant que l’Airbus ne défie la montagne.
Le choc propulsa Izel dix mètres plus loin, contre l’issue de secours. Ses deux adorables petites jambes gainées de noir se tordirent comme les membres d’une poupée de plastique entre les mains d’une fillette sadique ; sa mince poitrine s’écrasa contre le fer-blanc ; sa tempe gauche explosa contre l’angle de la portière.
Izel fut tuée sur le coup. En cela, elle fut la plus chanceuse.
Elle ne vit pas les lumières s’éteindre. Elle ne vit pas l’avion se tordre comme une vulgaire canette de soda au contact d’une forêt d’arbres qui semblaient un à un se sacrifier pour ralentir la course folle de l’Airbus.
Quand tout s’arrêta, enfin, elle ne sentit pas l’odeur de kérosène se répandre. Elle ne ressentit aucune douleur lorsque l’explosion déchiqueta son corps, ainsi que ceux des vingt-trois passagers les plus proches.
Elle ne hurla pas lorsque les flammes envahirent l’habitacle, piégeant les cent quarante-cinq survivants.