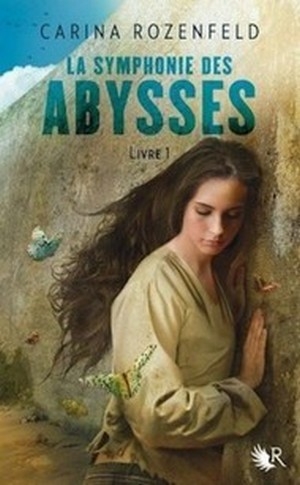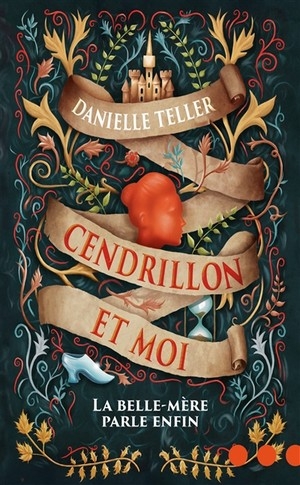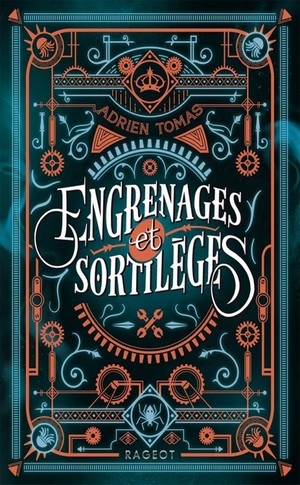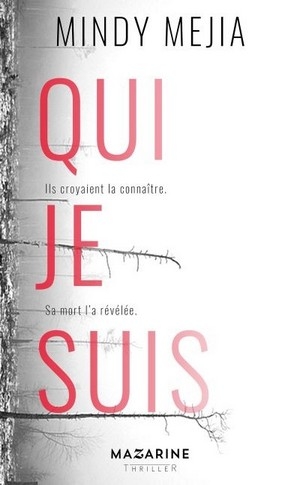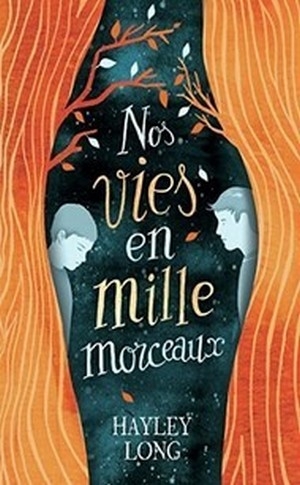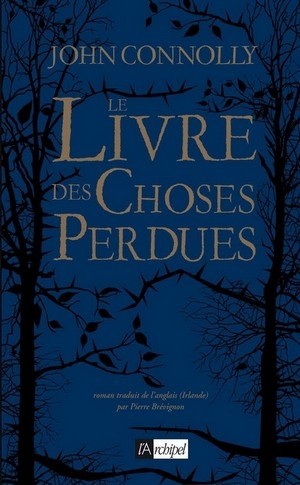Premières lignes est un rendez-vous livresque mis en place par Aurélia du blog Ma lecturothèque. La liste des participants est répertoriée sur son blog (Si ce n’est que son rdv est le dimanche et que je mettrai le mien en ligne chaque samedi).
Le principe est de, chaque semaine, vous faire découvrir un livre en vous en livrant les premières lignes.
Pour ma part, j’ai décidé de vous faire découvrir mes coups de cœurs !
Cette semaine, je vous présente Ash princess de Laura Sebastian
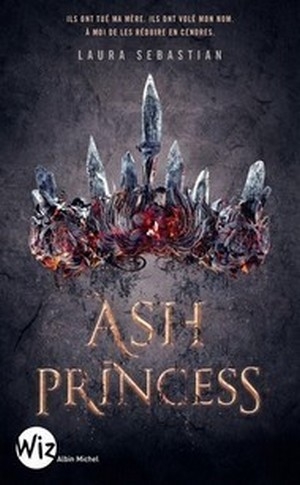
Prologue
La dernière personne qui m’ait appelée par mon vrai nom a été ma mère, juste avant de mourir. J’avais six ans ; ma main était encore assez petite pour que la sienne la recouvre entièrement — et elle la serrait si fort que le reste ne comptait presque plus à mes yeux. Si fort que j’ai à peine remarqué l’éclat argenté de la lame contre son cou, la peur dans son regard.
– Tu sais qui tu es, m’a-t-elle murmuré.
Sa voix n’a pas tremblé, même lorsque le sang a fleuri en gouttelettes sur sa peau, là où le poignard l’avait entaillée.
– Tu es le dernier espoir de notre peuple, Theodosia.
Puis la lame a tranché sa gorge. Et ils m’ont volé mon nom.
Thora
– Thora !
Je me retourne : de l’autre côté du vestibule du palais, tout en dorures, Crescentia se précipite vers moi, ses jupons de soie rose relevés à deux mains pour faciliter sa course, un grand sourire illuminant son ravissant visage.
Ses deux femmes de chambre ont du mal à suivre, leurs formes émaciées noyées dans de simples tuniques.
Évite soigneusement de regarder leurs visages, me dis-je. Cela ne m’a jamais fait plaisir de les voir, de scruter ces yeux ternes, ces lèvres affamées. Cela ne m’a jamais fait plaisir de constater à quel point elles me ressemblaient, avec leur peau basanée et leurs cheveux foncés. Cela ne fait que donner de la force à la voix qui résonne dans mon esprit. Et quand elle est assez sonore pour dépasser la frontière de mes lèvres, le Kaiser se fâche.
Ne pas mécontenter le Kaiser. Ainsi, il te laissera la vie sauve. Telle est la règle que j’ai appris à suivre.
Je concentre mon attention sur mon amie. Cress a le don de faciliter les choses. Elle porte son bonheur comme une couronne solaire ; elle s’en sert pour illuminer et réchauffer tous ceux qui l’entourent. Elle sait que j’en ai plus besoin que quiconque, raison pour laquelle elle n’hésite pas à m’emboîter le pas en se cramponnant à mon bras.
Elle n’est pas avare de ses sentiments, qualité que possèdent les quelques élus qui n’ont jamais perdu un être cher. Sa beauté spontanée, enfantine, ne l’abandonnera jamais, pas même dans le grand âge — son visage est tout en traits délicats, en grands yeux limpides qui n’ont jamais contemplé l’horreur. Sa pâle chevelure blonde est coiffée en une longue tresse qui pend par-dessus son épaule, étoilée de dizaines de Spirigemmes. Le soleil qui transperce les vitraux du vestibule les fait scintiller.
Je ne peux pas non plus regarder les gemmes, mais je ressens malgré tout leur présence. Une douce pression née sous ma peau me pousse vers eux, m’offrant leur pouvoir — je n’ai qu’à m’en emparer. Mais je ne le ferai pas. C’est impossible.
Autrefois, les gemmes étaient sacrées. Autrefois : avant la conquête d’Astrée par les Kalovaxiens.
Ces pierres précieuses viennent des grottes qui s’étendaient sous les quatre temples principaux — il y en avait un pour chaque grand dieu ou grande déesse – du feu, de l’air, de l’eau, et de la terre. Les grottes constituaient le cœur de leurs pouvoirs ; elles en étaient si profondément imprégnées que les gemmes qu’elles contenaient étaient devenues magiques à leur tour. Avant le siège, les dévots pouvaient passer des années dans les grottes des divinités auxquelles ils avaient prêté allégeance. Ils y adoraient leur déesse ou leur dieu : s’ils en étaient dignes, ils étaient bénis et s’imprégnaient eux aussi du pouvoir divin. Ils faisaient usage de ces dons pour servir Astrée et son peuple ; on les appelait « Gardiens ».
À cette époque, il était rare que le dieu ne bénisse pas ses adorateurs, même si cela se produisait — deux ou trois fois par an, peut-être. Ces bannis devenaient fous et mouraient rapidement. C’était un risque cependant, que ne prenaient que les croyants les plus sincères. Devenir Gardien était une vocation, un honneur ; mais chacun en comprenait les dangers.
Mais c’était il y a longtemps, cela. Une éternité. Avant.
Alors, tentés?