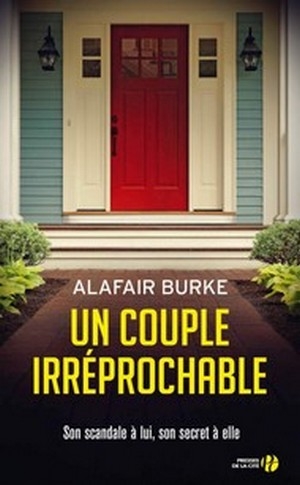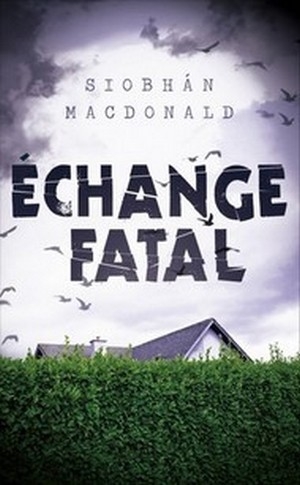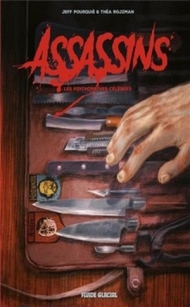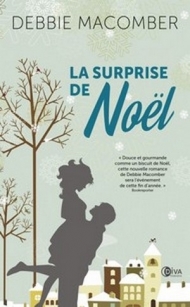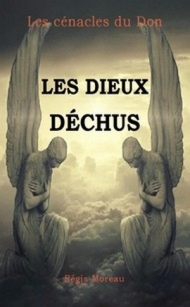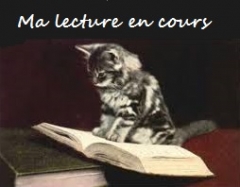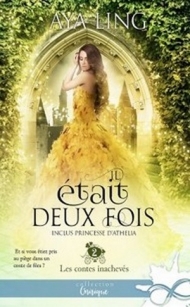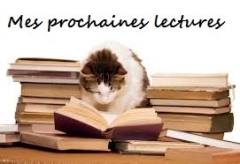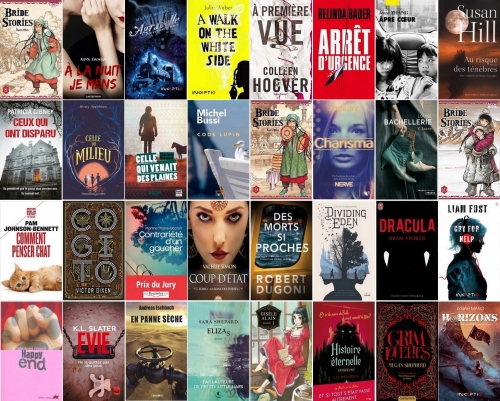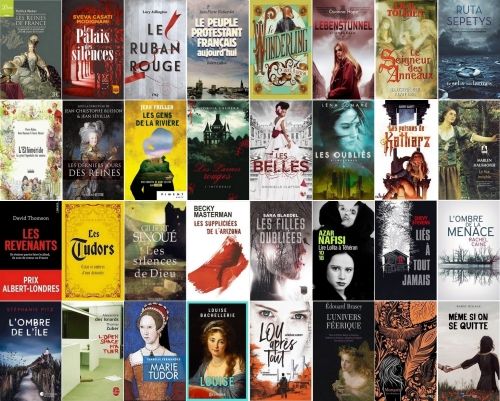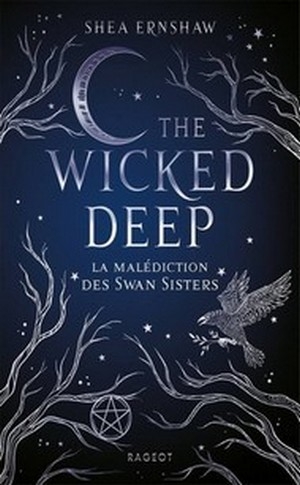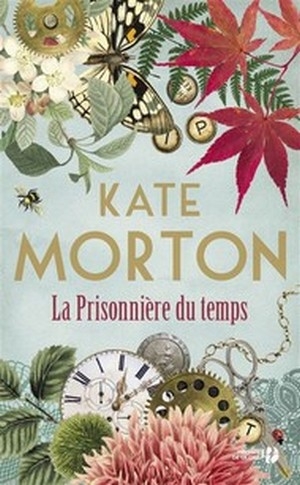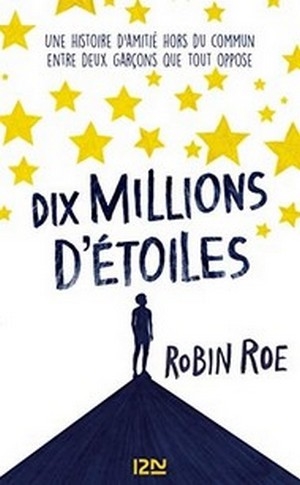Premières lignes est un rendez-vous livresque mis en place par Aurélia du blog Ma lecturothèque. La liste des participants est répertoriée sur son blog (Si ce n’est que son rdv est le dimanche et que je mettrai le mien en ligne chaque samedi).
Le principe est de, chaque semaine, vous faire découvrir un livre en vous en livrant les premières lignes.
Cette semaine, je vous présente Grace and fury de Tracy Banghart
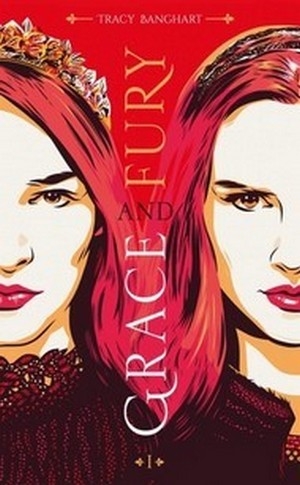
Serina Tessaro se trouvait sur les marches de la fontaine au centre de la grand-place de Lanos, parmi neuf autres jeunes filles de son âge toutes vêtues de leur plus belle robe. Son sourire éclatant semblait inaltérable, alors même que le crépuscule étouffant, accompagné d’une brume charbonneuse, pesait sur elle.
Signor Pietro jaugea chacune des candidates, les yeux mi-clos. Il les connaissait toutes depuis leur naissance, les observait, les évaluait, jugeait leur potentiel. Sa moustache poivre et sel frémit lorsqu’il pinça les lèvres.
La silhouette sombre et imposante des montagnes dominait la ville couverte de suie, ne laissant passer que les ultimes lueurs du jour. La famille de Serina se tenait un peu en retrait de la foule, dans l’ombre. Seules les joues rougies de Nomi étaient visibles. Même à cette distance, Serina percevait la fureur dans le regard de sa sœur. Leur frère, Renzo, laissait une main sur le bras de celle-ci, comme pour la retenir. Serina ne pouvait pas déchiffrer son expression, cependant elle était convaincue qu’il ne partageait pas l’excitation qu’affichaient leurs parents.
Signor Pietro se détourna des jeunes filles sur les marches de la fontaine pour s’adresser à l’assemblée réunie pour l’occasion. Il allait rendre son verdict. Serina sentait son cœur battre dans sa gorge, mais elle dissimulait son impatience derrière une apparente sérénité. Sa mère lui avait appris l’importance des masques.
— Cette année, pour la première fois, l’Héritier reprendra la tradition et se choisira trois Grâces. Chaque province est autorisée à envoyer une concurrente dans l’espoir d’accéder à cet honneur. En tant que gouverneur de Lanos, il m’incombe de choisir celle de nos filles qui entreprendra le voyage jusqu’à Bellaqua.
Peut-être marqua-t-il un silence. Peut-être chercha-t-il à faire durer le suspense. Et pourtant, contrairement à ce que Serina s’était imaginé, le temps ne ralentit pas. Le gouverneur continuait à égrener les mots de sa voix égale et dépassionnée, et ces mots étaient :
— J’ai choisi Serina Tessaro.
La foule applaudit. Une lueur d’espoir éclaira le regard de Mamma Tessaro. Nomi se décomposa.
Hébétée, Serina fit un pas en avant puis exécuta une révérence. Elle n’en revenait pas. Elle irait à Bellaqua. Elle quitterait la ville sale et étouffante de Lanos.
Elle en avait si souvent rêvé. Elle prendrait le train pour la première fois et traverserait les paysages luxuriants de Viridia. Elle découvrirait la ville du Supérieur, avec ses canaux et son immense palais de marbre. Elle rencontrerait l’Héritier. Il serait aussi beau qu’un prince de conte de fées.
Et, s’il la choisissait, elle vivrait dans son beau palazzo jusqu’à la fin de ses jours. Elle n’aurait jamais à travailler dans une usine de textile comme sa mère ou à devenir servante comme sa cousine. Pas plus qu’elle ne serait forcée d’épouser l’homme prêt à débourser le plus pour obtenir sa main. Elle assisterait à des bals somptueux et ne manquerait de rien. Sa famille ne connaîtrait pas non plus le besoin. Et même Nomi, en dépit de ses réticences, vivrait une vie meilleure : elle quitterait Lanos, elle aussi, puisqu’elle serait au service de sa sœur.
Alors, tentés?