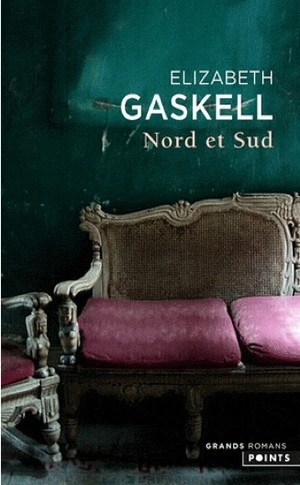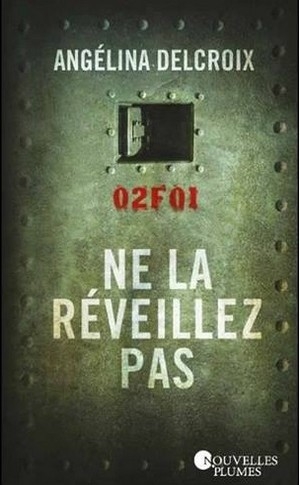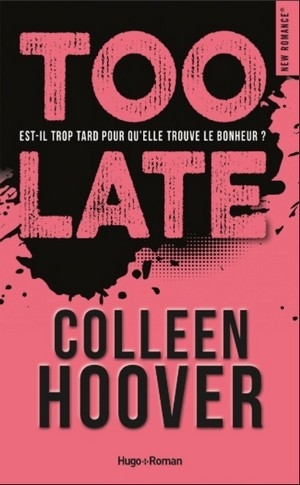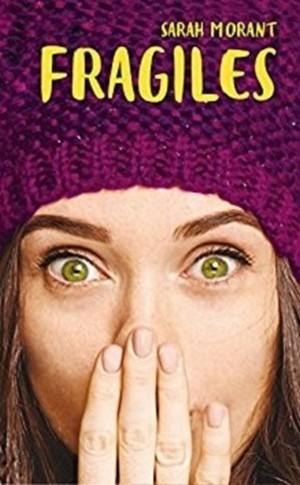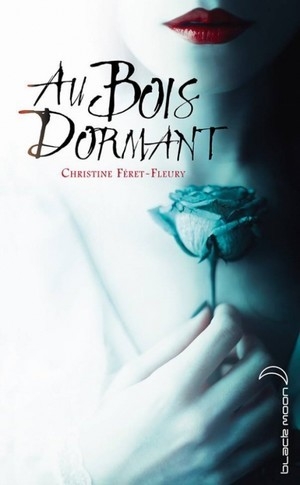Premières lignes est un rendez-vous livresque mis en place par Aurélia du blog Ma lecturothèque. La liste des participants est répertoriée sur son blog (Si ce n’est que son rdv est le dimanche et que je mettrai le mien en ligne chaque samedi).
Le principe est de, chaque semaine, vous faire découvrir un livre en vous en livrant les premières lignes.
Cette semaine, je vous présente Fangirl de Rainbow Rowell
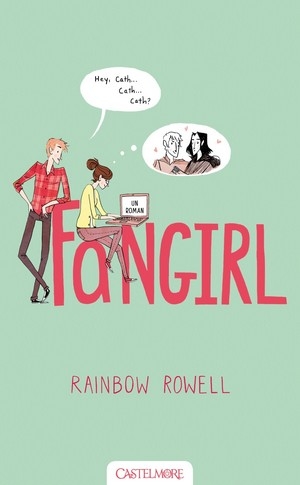
Simon Snow - Wikipédia, l’encyclopédie libre
Cet article concerne la série de littérature jeunesse « Simon Snow ». Pour les sujets homonymes, voir « Simon Snow » (homonymie).
Simon Snow est une suite romanesque de Fantasy en sept tomes écrite par la philologue anglaise Gemma T. Leslie. Les livres racontent l’histoire de Simon Snow, un jeune orphelin de onze ans originaire du Lancashire, en Angleterre, qui se voit invité à suivre sa scolarité à l’École de Magie de Watford où sont formés de puissants magiciens. Simon grandit, mûrit, au sein de l’établissement, et intègre un groupe d’enchanteurs, les Mages, qui luttent contre la Monotonie rampante, une créature maléfique qui tente de débarrasser le monde de toute trace de magie.
Depuis la parution de Simon Snow et l’héritier du Mage, en 2001, les livres ont été traduits en 53 langues et, en août 2011, ont atteint les 380 millions d’exemplaires vendus.
Les critiques ont souvent reproché à Leslie la violence de la série, ainsi que le mauvais caractère et l’égocentrisme de son héros. En 2008, une scène d’exorcisme présente dans le quatrième tome, Simon Snow et les quatre selkies, incite certains groupes chrétiens américains à boycotter la série. Pour autant, la saga devient très vite un classique de la littérature jeunesse dans de nombreux pays, et, en 2010, Le Monde qualifie Simon de « héros littéraire pour enfant le plus mémorable depuis Huckleberry Finn ».
Un huitième tome, le dernier de la série, sortira le 1er mai 2012.
Publications
Simon Snow et l’héritier du Mage, 2001
Simon Snow et le deuxième serpent, 2003
Simon Snow et la troisième porte, 2004
Simon Snow et les quatre selkies, 2007
Simon Snow et les cinq lames, 2008
Simon Snow et les six lapins blancs, 2009
Simon Snow et le septième chêne, 2010
Simon Snow et la huitième danse, sortie prévue le 1er mai 2012
Chapitre premier
UN GARÇON SE TROUVAIT CHEZ ELLE.
Cath leva les yeux vers le numéro peint sur la porte, avant de relire le papier sur lequel étaient inscrites les références de la chambre qu’on lui avait attribuée.
« Pound Hall, 913. »
Elle était bien au 913, pas de doute là-dessus, mais, pour Pound Hall, elle en était moins sûre : les dortoirs se ressemblaient comme autant de gouttes d’eau, ici, à l’instar des tours de gériatrie dans lesquelles l’État parque les personnes âgées. Peut-être Cath devrait-elle joindre son père avant qu’il monte le reste des cartons…
— Cather, c’est bien ça ? l’interrogea le jeune homme tout sourires, la main tendue vers elle.
— Cath, répondit-elle, l’estomac taquiné par la panique.
Elle fit mine de ne pas voir la main accueillante… Qui plus est, elle portait un carton : à quoi s’attendait ce type, au juste ?
Ce devait être une erreur. Il fallait que c’en soit une ! Elle savait que Pound Hall était un dortoir mixte, mais de là à s’imaginer qu’il pouvait exister des chambres mixtes…
Le jeune homme saisit le carton qu’elle portait, puis le posa sur l’un des deux lits encore inoccupé. Le second, à l’autre bout de la pièce, croulait déjà sous un tas de vêtements et de boîtes en tout genre.
— Tu as encore des affaires, en bas ? lui demanda-t-il. On vient de finir, nous. Je crois qu’on va filer se prendre un burger. Ça te dit un burger ? Tu connais Pear ? Tu y es déjà allée ? Ils font des burgers aussi gros que ton poing, là-bas.
Il s’approcha, prit un des bras de Cath et le leva à hauteur d’épaule. Elle déglutit.
— Ferme le poing pour voir…
Elle s’exécuta.
— Non : plus gros que ton poing, même, déclara-t-il, avant de lâcher son bras, puis de récupérer le sac à dos qu’elle avait déposé devant la porte. Tu as d’autres cartons ? Forcément, oui : tu ne peux pas être venue juste avec ça… Tu as faim, au fait ?
Grand et mince, il avait la peau mate, et ses cheveux d’un blond sombre qui fuyaient en tous sens donnaient l’impression qu’il venait de retirer un bonnet de laine. Cath baissa de nouveau les yeux vers le document du secrétariat. C’était lui, Reagan ?
— Reagan ! lança avec enthousiasme le jeune homme. Regarde ! Ta coloc vient d’arriver !
Une jeune fille tout juste débarquée du couloir contourna Cath et lui adressa un regard détaché par-dessus l’épaule. Elle avait des cheveux auburn satinés, et une cigarette éteinte pendait à ses lèvres. D’un geste vif, le jeune homme s’en empara et la mit à sa bouche.
— Reagan, Cather. Cather, Reagan, annonça-t-il.
— Cath, répéta la jeune femme.
Reagan lui adressa un hochement de tête, puis plongea la main dans son sac à la recherche d’une autre cigarette.
— Je me suis posée de ce côté, dit-elle en désignant du menton la pile de cartons entassés dans la partie droite de la chambre. Cela dit, je m’en cogne un peu d’être ici ou là ; donc, si t’es du genre acharnée du feng shui, hésite pas à bouger mon bordel.
Alors, tentés?