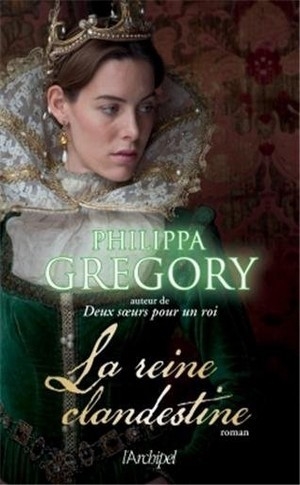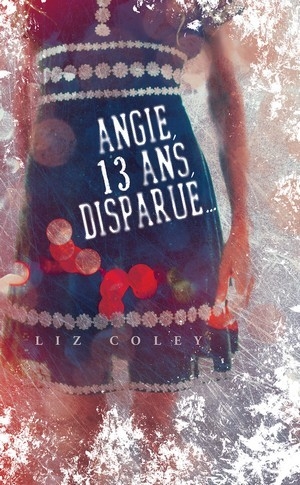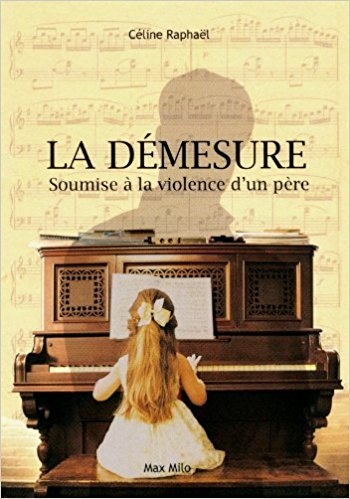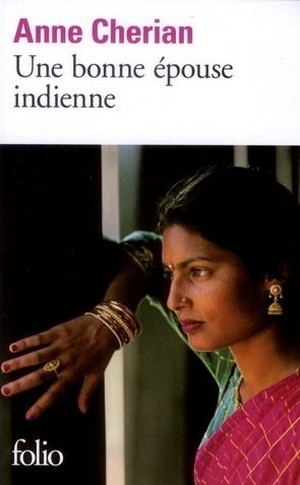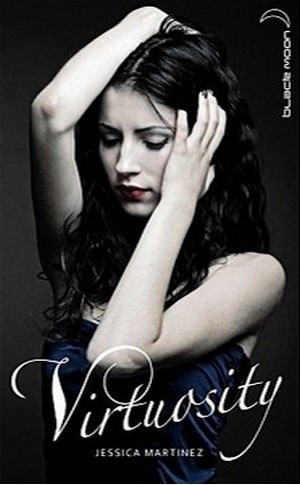Premières lignes est un rendez-vous livresque mis en place par Aurélia du blog Ma lecturothèque. La liste des participants est répertoriée sur son blog (Si ce n’est que son rdv est le dimanche et que je mettrai le mien en ligne chaque samedi).
Le principe est de, chaque semaine, vous faire découvrir un livre en vous en livrant les premières lignes.
Pour ma part, j’ai décidé de vous faire découvrir mes coups de cœurs !
Cette semaine, je vous présente Ma raison de vivre de Rebecca Donovan dont vous pouvez lire le résumé et ma chronique ICI
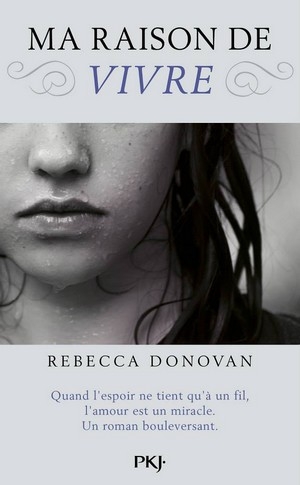
Inspirer.
Souffler.
Les yeux humides et la gorge serrée, j’ai avalé ma salive. Énervée par ma propre faiblesse, j’ai essuyé rageusement la larme qui glissait sur ma joue. Je devais chasser ces pensées. Et tenir le coup.
Mon regard a erré sur les rares meubles de ce qui me tenait lieu de chambre : un vieux bureau et une chaise bancale achetés dans un vide-greniers, ainsi qu’une petite commode qui avait dû, elle aussi, connaître de nombreux propriétaires. Aucune photo aux murs, pas le moindre souvenir de ma vie d’avant. Cette pièce était mon refuge, le seul espace où je pouvais me retirer, cacher ma souffrance, à l’abri des regards assassins et des mots cinglants.
Comment m’étais-je retrouvée là ? La réponse était simple : je n’avais pas d’autre endroit où aller. Ils étaient la seule famille qui me restait. Les seuls à pouvoir m’accueillir.
Pour échapper à ces sombres pensées, je me suis allongée sur mon lit et j’ai essayé de me concentrer sur mes devoirs. En tendant le bras pour attraper mon livre de maths, j’ai laissé échapper un gémissement. La douleur était déjà bien là, une douleur lancinante qui me transperçait l’épaule. Les souvenirs ont aussitôt resurgi. La colère est montée en moi. J’ai serré les poings de rage, les mâchoires crispées, tandis que les images défilaient devant mes yeux.
Respirer.
J’ai fermé les paupières et pris une profonde inspiration pour laisser le vide m’envahir. Il fallait à tout prix lutter, ne pas laisser ces pensées gagner mon cerveau. Je me suis plongée dans mon livre.
C’est un léger bruit à ma porte qui m’a réveillée, une heure plus tard. Je me suis redressée vivement et, scrutant l’obscurité de la chambre, je me suis efforcée de reprendre mes esprits.
— Oui ? ai-je dit, tendue.
— Emma ? a répondu une voix flûtée tandis que ma porte s’ouvrait tout doucement.
— Tu peux entrer, Jack.
Sa petite tête est apparue dans l’entrebâillement. Il a jeté un œil autour de moi avant de me regarder d’un air inquiet. Du haut de ses six ans, il avait déjà compris beaucoup de choses.
— Le dîner est prêt, a-t-il annoncé en baissant les yeux.
Il semblait presque malheureux d’être le messager de cette information.
— J’arrive, ai-je répondu avec un sourire forcé.
Tournant les talons, il est sorti de la chambre. De la salle à manger m’est parvenu le bruit des assiettes et des verres qu’on pose sur la table, accompagné du joyeux babillage de Leyla. Je connaissais la suite : dès que je rejoindrais la jolie petite famille, l’atmosphère se chargerait d’électricité. Comme si ma seule présence était un outrage à ce bonheur parfait.
Je me suis armée de courage et, à pas lents et l’estomac noué, je les ai rejoints. Les yeux baissés, je suis entrée. Heureusement, elle ne m’a pas vue tout de suite.
— Emma ! s’est écriée Leyla en se précipitant vers moi.
À l’instant où je me suis penchée pour la prendre dans mes bras, j’ai senti cette douleur à l’épaule. Je me suis mordu les lèvres pour ne pas crier.
— Tu as vu mon dessin ? m’a-t-elle demandé en montrant fièrement une grande feuille recouverte de coups de feutres roses et jaunes.
Dans mon dos, j’ai deviné son regard meurtrier.
— Maman, tu as vu mon tyrannosaure ! a lancé Jack pour attirer l’attention de sa mère.
— Il est très beau, mon chéri, a-t-elle répondu.
— C’est magnifique, ai-je glissé à Leyla. Va te mettre à table, maintenant, s’il te plaît.
À seulement quatre ans, elle était à mille lieues d’imaginer que sa démonstration de tendresse avait déclenché les hostilités. J’étais sa grande cousine qu’elle adorait, elle était mon soleil dans cette maison de malheur. Comment aurais-je pu lui en vouloir de son affection ? Mais j’allais le payer cher.
La conversation a repris et je suis redevenue invisible aux yeux de tous. Après avoir attendu qu’ils se soient servis, j’ai pris à mon tour du poulet et des pommes de terre. Sentant que chacun de mes gestes était épié, je n’ai pas levé les yeux de mon assiette. Ma maigre ration ne suffirait pas à calmer ma faim, je le savais. Mais je n’avais pas osé en prendre davantage.
Elle parlait sans cesse, racontant dans ses moindres détails sa journée au bureau. Sa voix me retournait l’estomac. George, comme toujours, la réconfortait avec des paroles gentilles. Lorsque j’ai demandé à voix basse si je pouvais sortir de table, il m’a lancé un de ses regards insaisissables et a hoché la tête en guise d’autorisation.
J’ai emporté mon assiette à la cuisine, ainsi que celles de Jack et Leyla qui avaient déjà filé dans le salon pour regarder la télé. Ma routine du soir commençait : débarrasser, rincer les assiettes avant de les mettre dans le lave-vaisselle, puis laver les plats et les casseroles que George avait utilisés pour préparer le dîner.
J’ai attendu que tout le monde soit dans le salon avant de prendre ce qui restait sur la table. Après avoir fait et rangé toute la vaisselle, sorti les poubelles et passé la serpillière dans la cuisine, je suis retournée dans ma chambre. Le plus discrètement possible, j’ai traversé le salon où les enfants riaient et dansaient devant la télévision. Personne ne m’a remarquée, comme d’habitude.
Je me suis allongée sur mon lit, j’ai mis mes écouteurs et ai monté le volume à fond pour laisser la musique m’envahir. Le lendemain, j’avais un match. Je rentrerais tard et n’assisterais donc pas à ce merveilleux dîner de famille. Une journée supplémentaire s’écoulerait, rendant plus proche le moment où, enfin, tout cela serait derrière moi. Quand je me suis tournée sur le côté, la douleur m’a cruellement rappelé ce que « tout cela » était. J’ai éteint la lumière et me suis laissé bercer par la musique pour trouver le sommeil.
Alors, tentés?